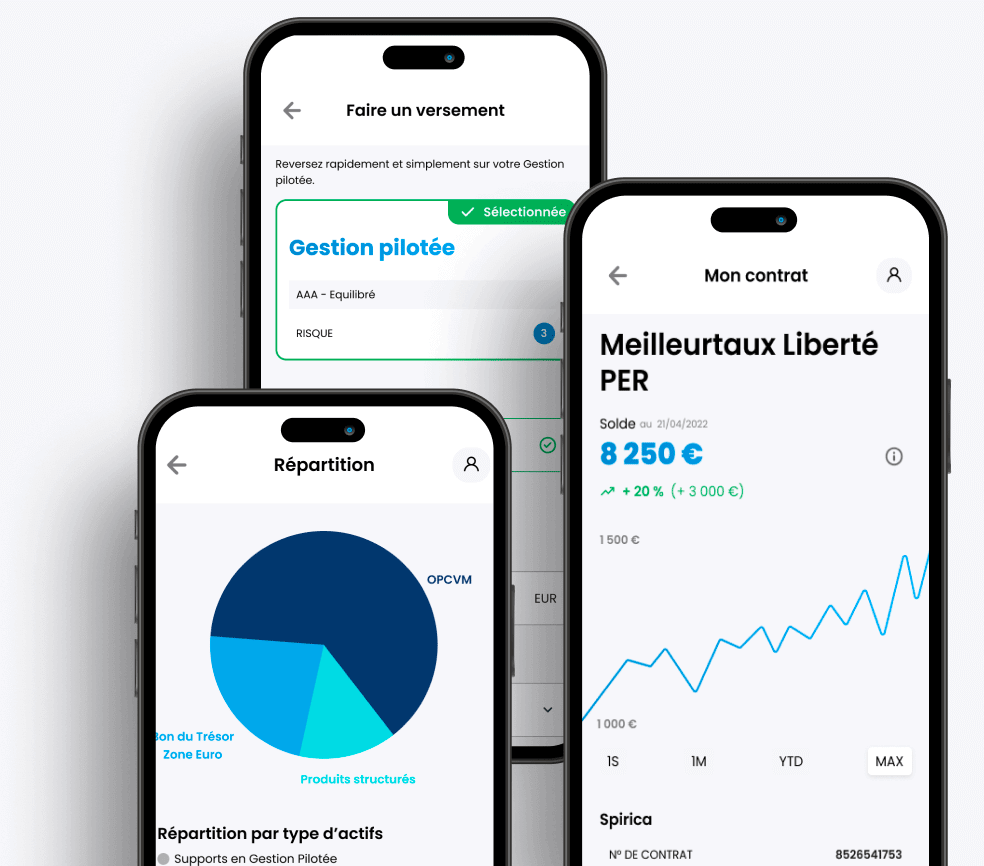Qu'est ce qu'une action ?
Une action est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une entreprise. En devenant actionnaire d'une entreprise, vous devenez en fait propriétaire d'une petite partie de cette société. Et cela vous donne des droits :
Droit sur la gestion :
Lorsque vous possédez des actions d'une société, vous pouvez participer à la gestion de la société en qualité d'associé, grâce au droit de vote attaché à chaque action (certaines actions ont même un droit de vote double). Ce droit de vote vous permet de participer aux assemblées générales de la société et d'exprimer un choix.
Droit sur les bénéfices :
Les bénéfices d'une société peuvent être distribués aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. C'est un choix qui est soumis aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle. Si la société ne distribue pas ses résultats ou partie de ses résultats, ceux-ci vont être mis en réserve. Il faut noter que la mise en réserve ne pénalise pas l'actionnaire, car cet acte renforce l'actif net de l'entreprise.
Droit sur l'actif net :
S'il advenait que la liquidation de la société soit prononcée, les biens disponibles après le règlement des dettes (l'actif net) seraient distribués aux actionnaires proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent.
En conclusion :
En devenant actionnaire d'une entreprise, vous devenez propriétaire de cette entreprise, à hauteur de votre nombre d'actions. Les actions permettent de prendre part directement à la vie d'une entreprise : vous profitez de sa bonne santé et... souffrez de ses difficultés.
Qu'est ce qu'un cours de Bourse ?
S'il est possible d'acquérir des actions d'entreprises non cotées (notamment entreprises familiales), la plupart des actions sur lesquelles les particuliers investissent sont cotées en Bourse.
On désigne par Bourse un marché organisé d'instruments financiers, qui permet de réunir l'ensemble des offres et des demandes. Dans ce cas, les contreparties ne négocient pas bilatéralement, mais placent des ordres d'achat et de vente dont la confrontation va permettre de dégager un prix pour le titre négocié. Le fonctionnement de ce marché est assuré par une entreprise de marché qui en définit les règles, habilite les participants, organise et supervise les négociations, et veille au bon fonctionnement des infrastructures techniques.
C'est la société NYSE Euronext qui gère la Bourse de Paris, le principal marché réglementé français. La société est issue de la fusion en 2000 des Bourses de Paris, Amsterdam, et Bruxelles, et plus tard de la Bourse portugaise. En 2006 Euronext a fusionné avec le NYSE Group pour ainsi créer la société holding NYSE Euronext. Le NYSE (New York Stock Exchange) est la Bourse de New-York. Grâce à ces fusions, NYSE Euronext est aujourd'hui la plus importante société de marchés d'actions du monde.
Euronext reçoit chaque jour des milliards d'ordres d'achat et de vente sur les actions, transmis par des particuliers mais surtout des investisseurs professionnels. En temps réel (sauf pour certaines actions dont la cotation n'est pas continue), Euronext confronte les ordres d'achat et de vente et conclut les transactions si les prix correspondent. Dès qu'il y une transaction, il y a donc une cotation au prix de l'échange. Le cours de bourse d'une action est ainsi le prix auquel la dernière transaction s'est faite.
Sur quel indice trouve-t-on les actions ?
En France, les 40 plus grosses sociétés font partie de l'indice CAC 40. Leur capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de leurs actions en Bourse, est comprise entre 7 et 150 milliards d'€. Derrière les 40 plus grosses capitalisations françaises, les 20 suivantes font partie de l'indice CAC next 20 et les 60 suivantes le CAC mid 60. Ensemble, les 3 indices forment le SBF 120. La plus petite société de l'indice SBF a une capitalisation boursière de 500 millions d'€.
Ensuite, il y a l'indice CAC mid 100, et l'indice CAC small 90. Ensemble, ces 2 indices forment le CAC mid & small 190. La plus petite société de l'indice CAC mid & small 190 a une capitalisation boursière de 2 millions d'€.
Les petites capitalisations françaises peuvent également choisir d'être cotées sur Euronext Growth: Il s'agit d'un marché boursier avec des modalités d'admission et de cotation assouplies qui sied mieux au développement des petites et moyennes entreprises. Il y a plus de 130 sociétés cotées sur ce marché.
En Allemagne, la Deutsche Börse gère la bourse allemande et son indice-phare, le DAX 30. Mais il y aussi les indices MidDax et SmallDAX. Au Royaume-uni Uni c'est le London Stock Exchange qui gère l'indice " Footsie " FTSE 100 ou encore l'indice FTSE 250. Ailleurs en Europe, on retrouve les indices italiens MIB, Suisse SMI ou espagnol IBEX 35
Aux États-Unis, il existe non pas une mais deux grandes Bourses. Le NYSE qui est la Bourse historique de Wall Street et dont l'indice phare est le Dow Jones Industrial Average 30, et le Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, et son indice le Nasdaq 100. Les valeurs des deux marchés sont regroupées dans l'indice S&P 500 alors que l'indice-phare des small caps est le Russell 2000. Ailleurs dans le monde, on citera également les indices canadien TSX, brésilien Bovespa, russe RTS, japonais Nikkei, indien Sensex, ou encore les indices chinois Shanghai Composite et hong-kongais Hang Seng.
À l'intérieur de chaque indice, il existe généralement des sous-indices sectoriels. Sur les valeurs des indices CAC par exemple, il y a les indices CAC chemical, CAC electricity, CAC pharmacy & Bio et beaucoup d'autres indices sectoriels
Comment acheter une action en Bourse ?
Le compte-titres ordinaires (CTO) est une enveloppe bancaire permettant à un investisseur d'acheter des valeurs mobilière (ex : actions ) françaises, européennes ou internationales. Le compte est composé d'une partie titres et d'une partie espèces.
Pour acheter une action en Bourse, l'investisseur va passer un ordre d'achat sur son compte titres, auprès de sa banque ou de son courtier en ligne.
Vous pouvez ouvrir un (ou plusieurs) compte-titres auprès de banques spécialisées dans le courtage en ligne ou auprès des établissements traditionnels. Le titulaire n'est soumis à aucun plafond d'investissement. Selon l'intermédiaire, les ordres de bourse peuvent se passer en ligne, au téléphone ou en agence avec son chargé de clientèle.
Exemple de courtiers en ligne :
Boursorama
Bourse Direct
Binck Bank
Fortuneo
Hello Bank
Esay Bourse
IG Markets
eToro
Pour passer un ordre, l'investisseur va préciser à son courtier (en ligne ou par téléphone), la valeur qu'il souhaite acheter (via son nom ou son code de Bourse appelé code ISIN), le nombre de titre qu'il faut acheter, et le prix maximum qu'il souhaite donner (ou alors le prix du marchéà.
Lorsqu'il voudra vendre le titre, il fera la même démarche, avec un ordre de vente
Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) est un type de compte-titres permettant de gérer un portefeuille d'actions e européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux (optimisation de la fiscalité sur les plus-values et les revenus des capitaux mobiliers). Il est accessible à toute personne majeure, mais uniquement pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA, auprès de banques spécialisées dans le courtage en ligne ou auprès des établissements traditionnels. Le montant maximum des versements est de 150.000€
Comment gagner de l'argent en Bourse ?
L'investisseur qui achète une action en Bourse va recherche soit à recevoir des dividendes, soit (ou en plus) à vendre le titre plus cher au bout d'un certains tant.
La distribution d'un dividende n'est pas automatique. Les bénéfices réalisés par une entreprise, après impôt, peuvent être soit mis en réserve, soit distribués aux actionnaires sous la forme de dividendes. Ce sont les actionnaires eux-mêmes (donc vous !) qui décident, ou non, de se distribuer une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Ils ont en fait deux options :
Soit ils touchent un dividende, donc des liquidités. C'est bien sûr très attractif pour les investisseurs qui recherchent un retour sur investissement. Mais une distribution trop forte peut fragiliser l'entreprise et nuire à la valeur des actions (voir le chapitre 2 sur les dividendes).
Soit ils conservent les liquidités dans l'entreprise afin de renforcer sa situation financière ou d'investir sur son développement. La valeur de leurs actions en sera alors forcément renforcée, et ils pourront réaliser à l'avenir une plus-value.
En plus du dividende, l'autre moyen de gagner de l'argent avec les actions est de réaliser une plus-value : C'est-à-dire vendre vos actions à un prix supérieur à votre prix d'achat. La plus-value est la différence entre ces deux prix : C'est-à-dire le gain (brut) de votre investissement.
Peu importe la raison (augmentation des résultats, rumeurs de rachat, secteur de plus en plus recherché, hausse des actions en général) et même s'il n'y a aucune explication, l'investisseur qui achète des actions souhaite forcement réaliser une plus-value.
Bien sûr, comme on peut réaliser une plus-value sur les actions, on peut aussi réaliser une moins-value si l'entreprise (ou son secteur, ou son marché, etc...) déçoit. Le prix des actions peut même descendre à zéro si l'entreprise fait faillite. Alors attention aux risques !
Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?
L'analyse fondamentale est le fait d'évaluer au plus juste la valeur d'une société (et donc de son cours de Bourse). Elle se base sur les données fondamentales de la société : Son bilan et son compte de résultats, ses perspectives, la valeur de ses actifs ou encore ses comparables du secteur. Elle tient aussi compte de la situation globale du pays et des critères suivants qui sont la croissance économique, le taux d'inflation et l'évolution de la consommation des ménages.
Ces études mettront en lumière la sur ou sous valorisation de la société étudiée. Une société est dite sous-évaluée lorsque son cours de Bourse est inférieur à la valeur calculée par l'analyse fondamentale.
Cette méthode, beaucoup pratiquée par les asset managers, reste difficile à mettre en place pour les particuliers. En effet, l'accès à l'information sur l'entreprise étant souvent limité, anticiper l'évolution de sa stratégie ou encore déterminer les résultats futurs de cette dernière est un exercice complexe.
Comment analyser le prix d'une action en Bourse ?
Pour juger de la valorisationd'une action, les analystes utilisent généralement des ratios.
Le prix d'une entreprise, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, correspond au prix qu'un investisseur devrait mettre pour acheter toutes les actions de l'entreprise. Pour évaluer ce prix, s'il est élevé ou non, on le compare au bénéfice réalisé par l'entreprise. Cela donne le price earning ratio (PER). Un PER de 8 signifie que la capitalisation boursière est 8 fois plus élevée que les bénéfices. On dit que " la société se paye 8 fois les bénéfices ". Mais le PER permet surtout d'évaluer le prix des actions d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Les sociétés d'un même secteur doivent avoir des PER proches. Si une de ces sociétés a un PER plus faible, elle est sous-valorisée.
Les PER moyens sont différents selon les secteurs. Certains secteurs, notamment les secteurs de croissance, ont des PER très élevés car les investisseurs sont prêts à acheter l'action très chère par rapport à ses bénéfices, car ils pensent que dans les années qui viennent les bénéfices vont grossir. Inversement, les secteurs défensifs vont avoir des PER souvent faibles car les investisseurs ne visent pas de fortes hausses des résultats. Outre le PER, il y a de nombreux ratios que l'on peut utiliser pour évaluer le prix d'une actiond'une entreprise par rapport à ses performances économiques. On retiendra :
Le Price to Sales Ratio :
Il se calcule en divisant la capitalisation d'une entreprise par son chiffre d'affaires. Il permet d'évaluer le prix d'une entreprise par rapport à ses ventes.
Le Price to book Ratio :
Ici on divise le prix d'une entreprise par ses fonds propres. Les fonds propres représentent la valeur comptable des actifs et passifs d'une entreprise.
Le Ratio VE/EBITDA :
Il se calcule en divisant la valeur de l'entreprise par l'EBITDA. La valeur de l'entreprise se calcule en additionnant la capitalisation boursière à la dette nette de l'entreprise. Elle représente la valeur théorique minimum de rachat de l'entreprise par un investisseur : Il doit acheter toutes les actions et aussi rembourser la dette. L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation d'une entreprise, avant les résultats financiers et exceptionnels et avant les impôts.
Le Gearing :
Il se calcule en divisant l'endettement net par les fonds propres. Plus le gearing est élevé, plus la dette sera lourde par rapport aux fonds propres de l'entreprise.
Qu'est ce que l'analyse technique ?
L'analyse des comptes d'une société et l'étude des ratios financiers constituent les critères déterminants pour l'évaluation d'une entreprise chez les analystes " fondamentaux ". Mais il existe un grand nombre de facteurs, difficilement identifiables, comme par exemple la psychologie des marchés, qui vont déterminer l'évolution future d'un titre.
Les analystes " techniques " estiment que l'étude des graphiques permet d'intégrer l'ensemble de ces facteurs et ainsi déceler des opportunités et des tendances à court terme sur le marché. Ces analystes sont également appelés les " chartistes ". Ils vont tenter de prévoir l'évolution future d'un titre au vue de son évolution passée.
Tout analyste chartiste va utiliser ce qu'on appelle des lignes de tendances, qui sont en fait l'indicateur de base de l'analyse technique.
On va par exemple retrouver les supports et résistances d'un titre. Un support correspond à un niveau de prix auquel une majorité d'investisseurs estime que le cours de l'action ne peut baisser davantage. Ils se mettent alors à l'acheter, empêchant du même coup son cours de descendre plus bas. A l'inverse, une résistance correspond à un niveau de prix auquel une majorité d'investisseurs estime que le cours de l'action ne peut monter davantage. Ils se mettent alors à la vendre, enrayant du même coup la montée du cours.
Un autre élément important de l'analyse technique correspond à l'étude des moyennes des cours observés sur une période glissante : Les moyennes mobiles. Celles-ci permettent d'éliminer les variations non significatives du titre et d'en dégager le mouvement général. Par exemple, une moyenne mobile de 20 jours correspond à la moyenne des cours de clôture des 20 derniers jours. Elle est recalculée tous les jours en remplaçant le cours le plus ancien par le cours le plus récent. Elles n'ont pas pour objet d'anticiper mais plutôt de déterminer des tendances à plus ou moins long terme par des signaux d'achat et de vente. En effet, lorsque le cours d'une action traverse à la hausse une moyenne mobile, cela constitue un signal d'achat, et un signal de vente lorsqu'il la traverse à la baisse.
Il existe un très grand nombre d'indicateurs dans le domaine de l'analyse technique. On retrouve par exemple les figures tête et épaule, le canal, les triangles ou encore le MACD.