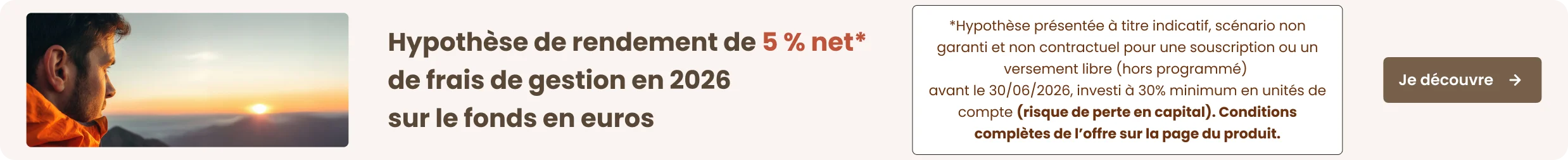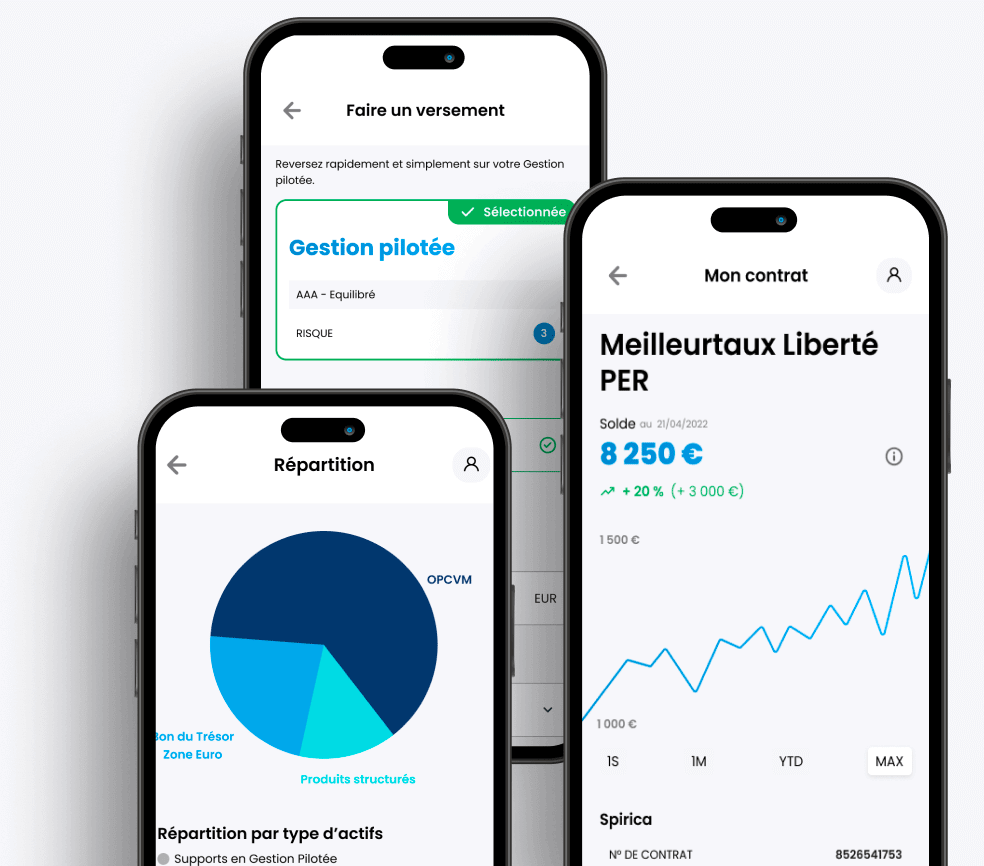Dans l’immobilier locatif, rien n’est jamais figé. Les règles fiscales et réglementaires évoluent sans cesse : les débats sur la location meublée, le durcissement des normes énergétiques, l’encadrement des loyers… Autant de changements qui compliquent la tâche des bailleurs privés.
Désormais, une nouvelle piste se dessine avec la proposition d’un statut de bailleur privé, présentée dans un rapport parlementaire et qui pourrait voir le jour dès 2026.
Le statut de bailleur privé, une piste de réforme à suivre de près
Le marché de l’immobilier locatif traverse une zone de turbulences.
Depuis plusieurs années, les dispositifs de soutien se succèdent, parfois sans grande lisibilité pour les investisseurs.
Après la montée en puissance du dispositif Pinel, puis son extinction programmée, après les débats sur la fiscalité des locations meublées ou encore le durcissement des règles pour les logements énergivores, un nouveau chantier s’ouvre : la création d’un « statut de bailleur privé ».
Proposé dans un rapport parlementaire remis au gouvernement le 30 juin 2025 par Marc-Philippe Daubresse et Lionel Cosson, ce statut pourrait être intégré au « projet de loi de finances pour 2026 ».
Il ne s’agit donc pas encore d’une réforme actée, mais d’une piste sérieuse qui pourrait changer en profondeur les règles du jeu pour les investisseurs particuliers.
Une réponse à un marché en crise
Les rapporteurs partent d’un constat : le marché est en panne.
Dans le neuf, seulement 2 448 réservations de logements locatifs au premier trimestre 2025, un plus bas historique depuis les années 1950.
Dans l’ ancien, à peine 845 000 transactions en 2024, le niveau le plus faible depuis dix ans.
À cela s’ajoutent la hausse des coûts de construction, la flambée des taux de crédit qui réduit drastiquement la capacité d’achat des ménages investisseurs, la fiscalité locale (taxe foncière en tête) et la pression réglementaire sur les performances énergétiques.
Résultat : les bailleurs privés désertent le marché, quand bien même la demande locative, elle, ne cesse de croître.
Investir en SCPI présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les mesures phares du statut
Le projet de statut de bailleur privé s’attaque d’abord à une réalité sociale : pour de nombreux ménages, accéder à un logement à louer relève aujourd’hui du parcours du combattant.
L’offre disponible se raréfie, alors même que la demande explose, en particulier dans les grandes villes.
Par ailleurs, la rentabilité du régime de la location meublée par rapport à la location nue longue durée conduit beaucoup d’investisseurs à se tourner vers la location meublée, sans que cela réponde à la demande de logements locatifs de longue durée.
Afin de rééquilibrer le marché en faveur de la location longue durée, le rapport propose la mise en place de dispositifs fiscaux spécifiques avec la création d’un « statut du bailleur privé ».
Le statut de bailleur privé reposerait sur cinq piliers fiscaux destinés à redonner de l’attrait à la location nue, souvent jugée moins rentable que la location meublée.
1. L’amortissement fiscal
Pour cette première proposition, il s’agit de permettre de déduire l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location nue pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter de décembre 2025.
Les propriétaires pourraient amortir une partie de la valeur de leur bien :
- 5 % par an pendant 20 ans pour un logement neuf ;
- 4 % par an dans l’ancien, à condition de réaliser des travaux représentant au moins 15 % du prix d’acquisition.
Un « bonus d’amortissement » de 0,5 à 1,5 % serait accordé aux bailleurs qui pratiquent des loyers “abordables”.
2. Le micro-foncier revisité
Le régime micro-foncier serait simplifié et élargi :
- Abattement forfaitaire de 50 % (au lieu de 30 % aujourd’hui) ;
- Plafond relevé à 30 000 € de loyers par an.
Là encore, un bonus d’abattement serait prévu en cas de loyers maîtrisés.
3. Le déficit foncier renforcé
Le plafond d’imputation sur le revenu global passerait de 10 700 € à 40 000 € par an.
Ce plafond n’a pas été revalorisé malgré la hausse continue des loyers et charges et la hausse des prix de l’immobilier.
4. L’allègement de l’IFI
Les biens effectivement loués en résidence principale du locataire seraient exclus de l’assiette de l’ Impôt sur la Fortune Immobilière.
5. La réforme des plus-values
Les cessions bénéficieraient d’une « exonération totale d’impôt et de prélèvements sociaux après 20 ans de détention ».
Actuellement, la plus-value est soumise à une imposition, mais cette nouvelle mesure devrait encourager les investisseurs à conserver leurs biens à long terme, et donc à stabiliser le marché immobilier.
Quels effets attendre ?
Le rapport parlementaire n’hésite pas à avancer des chiffres ambitieux :
- +90 000 logements par an à horizon 2030 (en additionnant le neuf, l’ancien et l’effet indirect sur les programmes mixtes) ;
- 100 000 emplois créés dans la filière du bâtiment et de la gestion ;
- Un « gain budgétaire net » estimé à près de 2 milliards d’euros par an entre 2026 et 2032, malgré les allégements fiscaux.
Autrement dit, la réforme est présentée comme gagnante à la fois pour les bailleurs, pour les locataires (grâce à l’encouragement aux loyers abordables) et pour les finances publiques.
Mais une incertitude persistante
Aussi séduisantes soient-elles, ces annonces ne sont pour l’instant qu’une « proposition ».
Rien ne garantit que le gouvernement les reprendra dans le projet de loi de finances 2026, ni qu’elles seront adoptées par le Parlement sans modification.
Or, c’est bien là le problème pour les particuliers : la fiscalité de l’investissement locatif change sans cesse.
Pinel, Denormandie, dispositifs d’amortissement, réformes du meublé, contraintes énergétiques… chaque gouvernement imprime sa marque, rendant difficile toute visibilité à long terme.
Investir en direct dans l’immobilier suppose déjà de trouver un bien, de gérer des locataires, de financer des travaux et d’assumer des risques d’impayés.
Si en plus le cadre fiscal n’est pas stable, la prudence est de mise.
La pierre papier, une alternative plus sereine
Pour ceux qui souhaitent profiter de la dynamique immobilière sans subir ces incertitudes, la « pierre papier », et notamment les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), constitue une alternative :
- l’investisseur n’a pas à gérer les locataires ni les travaux, tout est délégué à une société de gestion professionnelle.
- les SCPI permettent de diversifier car elles investissent dans un large portefeuille d’immeubles (bureaux, commerces, santé, résidentiel, logistique), répartis sur plusieurs zones géographiques.
- il est possible d’investir quelques centaines d’euros seulement, bien loin du prix d’acquisition d’un bien immobilier physique.
- les parts de SCPI peuvent être logées dans une assurance vie, achetées à crédit ou acquises au comptant.
Investir en SCPI présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
En conclusion, le « statut de bailleur privé » pourrait, s’il est adopté, redonner des couleurs à l’investissement locatif en France.
Amortissement, déficit foncier dopé, exonération de plus-value… le cocktail est séduisant sur le papier.
Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit pour l’instant d’une « proposition parlementaire », qui pourrait évoluer, être amendée ou même disparaître lors du débat budgétaire.
Dans ce contexte mouvant, les investisseurs qui recherchent la stabilité et la visibilité peuvent trouver dans la pierre papier une solution bien plus rassurante : une diversification solide, la possibilité de profiter sereinement des revenus immobiliers sans contraintes de gestion.
Investir en SCPI présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Communication non contractuelle à but publicitaire
Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques :
La baisse de la valeur du placement : le capital investi n’est pas garanti.
Sa valeur évolue dans le temps, en relation étroite avec l’état de la conjoncture de l’immobilier.
La diminution des revenus locatifs : due à la baisse du taux d’occupation financier et/ou du montant global des loyers versés.
La liquidité : l'immobilier n’étant pas un produit coté, il présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.