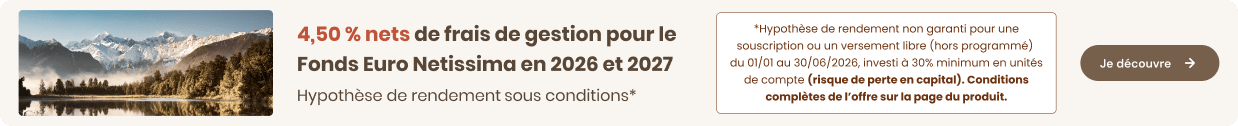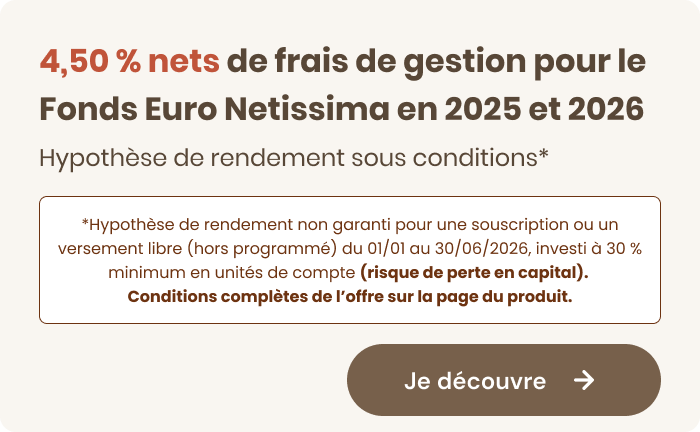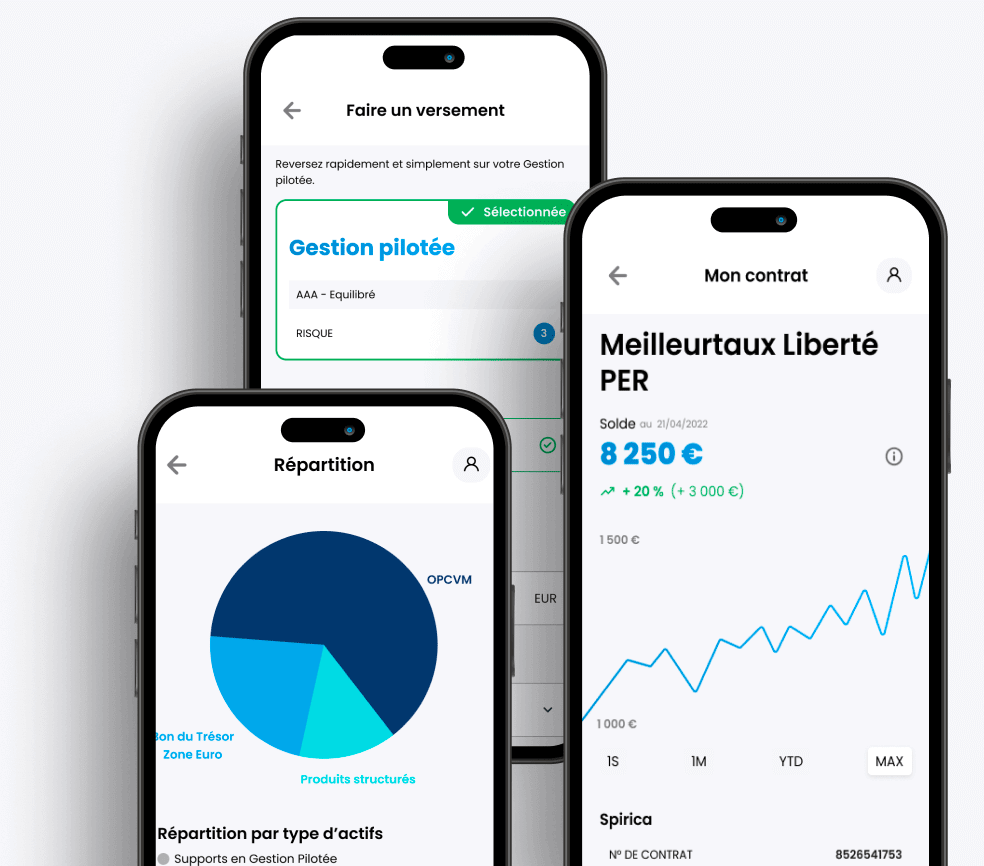La rentrée politique s’est transformée en véritable casse-tête budgétaire avec la chute du gouvernement Bayrou et l’arrivée de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, alors même que le projet de loi de finances pour 2026 doit être présenté début octobre. Premier signal envoyé : l’abandon de la mesure controversée de suppression de deux jours fériés, qui devait améliorer la productivité et générer plusieurs milliards d’euros de recettes. Une question centrale demeure : comment répondre à une dette publique ?
Une dette publique qui impose des choix douloureux
À la fin du 1er trimestre 2025, la dette publique française s’élevait à près de 3 345 milliards d’euros, soit 113,9 % du PIB. Sa charge annuelle représente désormais près de 60 milliards d’euros, l’équivalent du budget de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Et avec des taux d’intérêt durablement élevés, chaque nouvel emprunt accroît la pression sur les finances publiques.
Le déficit, lui, s’établit autour de 6 % du PIB en 2024, bien au-delà des critères européens. Cette dérive a déjà valu à la France un avertissement de Bruxelles et une dégradation de sa note souveraine par l’agence de notation Fitch Ratings ce vendredi 12 septembre.
Comme souvent en France, plutôt que de réduire la dépense publique, l’exécutif privilégie une hausse des recettes fiscales pour tenter de rééquilibrer les comptes.
Les mesures fiscales déjà sur la table
Avant de tomber, le gouvernement Bayrou préparait plusieurs pistes fiscales pour alimenter le budget 2026. Ces orientations pourraient encore inspirer le nouvel exécutif. L’idée centrale : cibler les plus hauts revenus et les patrimoines les plus importants pour espérer générer plusieurs dizaines de milliards d’euros de recettes supplémentaires.
Parmi elles :
- La reconduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Actuellement en vigueur à 3% (revenus supérieurs à 250 000 € par an pour une personne seule) et 4% (au-delà de 500 000 €), elle pourrait voir son taux relevé ou son seuil d’entrée abaissé. De même, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) qui vise à assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus et pourrait être reconduite pour 2026. Une contribution exceptionnelle qui pourrait donc s’inscrire dans le temps.
- Une extension de l’IFI voire un retour à l’ISF, qui ne taxe aujourd’hui que les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d’euros, mais qui pourrait à nouveau s’appliquer à d’autres classes d’actifs. Avant sa suppression en 2018, l’ISF taxait tous les ménages dont le patrimoine net excédait 1,3 million d’euros, incluant immobilier et actifs financiers, selon un barème progressif de 0,5% à 1,5% ; environ 350 000 foyers étaient concernés et ce prélèvement rapportait à l’État entre 4 et 5 milliards d’euros par an.
- La taxe Zucman, projet d’imposer de 1 à 2 % les patrimoines supérieurs à 50 millions d’euros. Si son rendement théorique a de quoi séduire, sa faisabilité technique fait débat, notamment sur la question des actifs non liquides (parts de start-up ou holdings familiales). La taxe a été très médiatisée ces derniers jours, notamment à la suite d’un sondage Ifop commandé par le Parti socialiste indiquant que 86% des Français s’y déclaraient favorables. Cela a suscité de vifs débats sur sa faisabilité technique, en particulier concernant la taxation des actifs non liquides (parts de start-up ou holdings familiales), et a provoqué de fortes réactions du côté de la French Tech, où de nombreux entrepreneurs dénoncent l’impact potentiel sur l’innovation et l’attractivité de l’écosystème numérique français.
- La suppression de certaines niches fiscales et sociales, souvent critiquées pour bénéficier avant tout aux ménages les plus aisés et aux grandes entreprises. Ce qui était envisagé : commencer par les dispositifs arrivant à extinction, afin d’élargir l’assiette des recettes sans provoquer de rupture brutale.
Être riche en France : une notion floue
Tous les gouvernements souhaitent donc “taxer les riches” mais encore faut-il déterminer qui est « riche » en France. Ce n’est pas simple, tant la notion varie selon que l’on considère les revenus ou le patrimoine. Selon l’Observatoire des inégalités, une personne seule est considérée comme riche lorsqu’elle dispose d’un revenu net mensuel supérieur au double du niveau de vie médian, soit environ 4 056 € en 2022, ce qui la place parmi les 10 % les mieux rémunérés. Pour le fisc, la notion de hauts revenus est plus stricte : sont concernés les foyers dont le revenu imposable annuel dépasse 250 000 €, seuil utilisé notamment pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur le plan patrimonial, les données de l’INSEE montrent qu’à début 2021, la moitié des ménages français possédait un patrimoine brut supérieur à 177 200 €, tandis que pour faire partie du 1 % des ménages les plus riches, il fallait disposer d’un patrimoine supérieur à 2,2 millions d’euros, souvent composé d’actifs financiers, immobiliers ou d’entreprises familiales.
Ce flou rend complexe la mise en place de mesures ciblées : trop larges, elles touchent des ménages aisés mais pas « riches », et si trop ciblées, les recettes fiscales seront limitées.
Anticiper : les solutions de défiscalisation à envisager
Que vous soyez riches ou non, vous pouvez souhaiter diminuer la facture fiscale et pour cela il existe des solutions permettant de réduire ses impôts tout en diversifiant son patrimoine.
Le Plan d’Épargne Retraite (PER)
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un produit d’épargne créé pour préparer la retraite tout en offrant un avantage fiscal immédiat.
Son fonctionnement est simple :
- Vous versez de l’argent sur votre PER (ponctuellement ou régulièrement).
- Ces versements sont déductibles de votre revenu imposable, ce qui fait baisser immédiatement votre impôt. Plus votre tranche d’imposition est élevée, plus l’avantage est important.
- L’argent est investi (fonds euros sécurisés, actions, obligations, immobilier…) et les sommes restent bloquées jusqu’à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé : achat de la résidence principale, accidents de la vie, etc.).
- Au moment de la retraite, vous récupérez votre épargne soit en capital, soit en rente viagère, soit un mix des deux.
Exemple : prenons le cas d’un cadre percevant 100 000 € de revenus imposables par an. À ce niveau, il est soumis à la tranche marginale d’imposition de 41%.
S’il décide de verser 15 000 € sur son PER, cette somme est déduite de son revenu imposable.
L’économie fiscale correspond donc à 41% de 15 000 €, soit 6 150 € d’impôt en moins dès l’année suivante.
Au-delà de la réduction immédiate, ce capital s’accumule pour constituer son épargne retraite.
Le FIP Corse
Les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) permettent d’investir dans des PME régionales. Le FIP Corse est particulièrement avantageux, avec un taux de réduction d’impôt de 30 % (contre 18 % pour les FIP « classiques »).
Son fonctionnement :
- Vous souscrivez des parts dans le fonds, qui lui-même investit dans plusieurs PME corses. Ces entreprises peuvent être dans des secteurs variés (tourisme, artisanat, agroalimentaire, services…).
- En contrepartie de ce soutien au tissu économique local, l’État accorde une réduction d’impôt de 30 % du montant investi. Par exemple, un versement de 10 000 € permet une économie d’impôt immédiate de 3 000 €. Le tout avec un ticket d’entrée accessible (souvent à partir de 1 000 €).
L’avantage fiscal ne doit cependant pas être le seul élément pris en compte. Le FIP Corse reste un placement : au terme de la période de blocage des fonds (7 à 9 ans), l’investisseur récupère son capital, qui peut avoir généré une plus-value… comme subir une moins-value, selon les performances des entreprises soutenues.
Attention toutefois : il s’agit d’un placement à long terme (blocage légal pendant 7 à 9 ans) et le capital n’est pas garanti.
Le Groupement Forestier d’Investissement (GFI)
Un GFI (Groupement Forestier d’Investissement) est un placement collectif qui permet à des particuliers d’investir dans la gestion et la valorisation de forêts en France.
Son fonctionnement :
- Vous achetez des parts d’un GFI, qui lui-même détient et gère des parcelles forestières.
- Le groupement tire principalement ses revenus de l’exploitation durable du bois (coupes, ventes).
- En tant qu’investisseur, vous pouvez percevoir des revenus potentiels, mais surtout diversifier votre patrimoine avec un actif tangible et peu corrélé aux marchés financiers.
Sur le plan fiscal, le GFI offre des avantages spécifiques, parmi lesquels un abattement sur l’IFI, ainsi que des réductions d’impôt et des conditions fiscales favorables en matière de succession et de donation, variables selon le type de GFI.
En résumé, le GFI est une solution pour les épargnants qui cherchent à allier rendement potentiel, diversification patrimoniale et avantages fiscaux, tout en finançant une filière durable et essentielle pour la transition écologique.
À noter : Il convient de rappeler que la plupart de ces dispositifs de défiscalisation sont soumis au plafond global des niches fiscales, fixé à 10 000 € par an. Seul le PER échappe à ce plafond et obéit à ses propres règles, avec une limite de déduction calculée en fonction des revenus professionnels.
En conclusion, le budget 2026 s’annonce comme un exercice délicat pour Sébastien Lecornu. Il devra trouver un équilibre entre la volonté de restaurer la crédibilité financière de la France, fragilisée par une dette record, et la nécessité de composer avec une majorité politique encore instable. Dans ce contexte, une taxation accrue des plus hauts revenus et patrimoines pourrait bien être mise à contribution.
Pour les contribuables concernés, l’anticipation reste essentielle. Des solutions existent pour réduire sa fiscalité et sécuriser son patrimoine.
Communication à caractère promotionnel
Les FCPI et les FIP sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme. Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Les frais d'entrée indiqués sur notre site correspondent aux frais réels prélevés à la souscription, et non aux frais théoriques étalés sur la durée de détention du fonds tels que mentionnés par la société de gestion dans le DICI et la plaquette de présentation. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.
Les GFI sont des placements qui varient à la hausse ou à la baisse en fonction des variations du marché des forêts et du bois. Les parts doivent être acquises dans une optique de long terme. Le GFI ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi et du taux de distribution de dividendes. Ces placements présentent un risque de perte en capital. La Société de Gestion ne garantit pas les conditions de revente des parts. Compte tenu de la durée de blocage et du risque de perte en capital, il est conseillé aux souscripteurs d'y consacrer un montant limité de leurs actifs (dans la limite de 5 à 10 % maximum selon les professionnels).